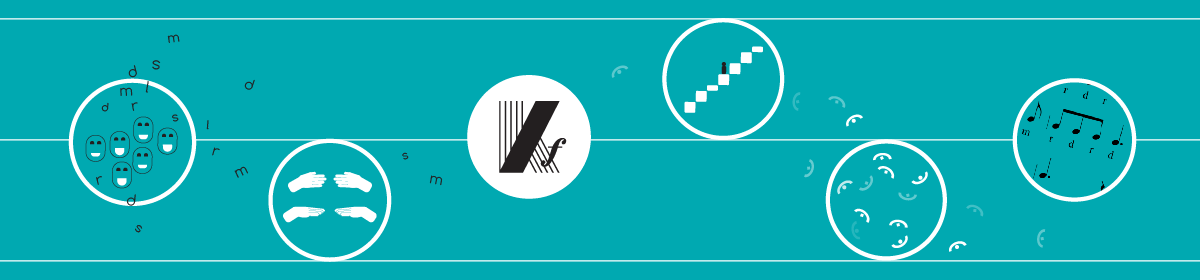Professeur de formation musicale depuis presque 10 ans, issu du système classique de formation à la française, j’ai découvert la pédagogie Kodály depuis quelques années par les stages organisés en France par les associations Bouge et Chante et La Voix de Kodály en France. D’abord surpris par certains outils, notamment la solmisation, j’ai été progressivement convaincu de la pertinence fondamentale de cette pédagogie pour l’enseignement de la musique. Il m’a donc semblé essentiel d’aller à un moment « à la source », en Hongrie, pour être sûr d’avoir saisi l’essentiel de cette pédagogie.
Je suis donc parti en Hongrie à l’été 2025, profitant du fait que le Séminaire d’été se mélangeait avec le Symposium International en deuxième semaine. J’ai été à Kecskemét du 25 juillet au 8 août, et cela a été deux formidables semaines. Nous étions une centaine d’élèves en première semaine, rejoints par deux cent autres personnes en deuxième semaine, pour un total d’une quarantaine de nationalités, venant littéralement du monde entier : Espagne, Grèce, Italie, Autriche, Japon, Chine, Canada, Etats-Unis, Inde, etc. Avec des profils très variés, et des personnes enseignant la musique de la maternelle à l’université. L’un des points intéressants, c’est que quasiment tout le monde était déjà formé aux outils Kodály (pour certains car ils avaient déjà passé du temps à l’Institut de Kecskemét, pour d’autres car ils avaient bénéficié d’une formation dans leur pays), donc nous pouvions aller assez vite sur des choses intéressantes, sans repasser par des choses trop basiques.
Il s’est passé énormément de choses durant ces deux semaines, je ne peux donc pas tout mettre dans ce témoignage, je vais me contenter de parler de ce qui m’a particulièrement plu. Déjà, soulignons le cadre très agréable de l’Institut de Kecskemét, situé dans le très joli centre-ville de la commune. C’était la première édition du Séminaire d’été après une grosse rénovation, il y avait donc un charmant mélange d’être à la fois dans du neuf (la rénovation impeccable) et dans du vieux (les murs vieux de plusieurs siècles). Un élément m’a surpris : les salles sont généralement assez petites, pour les cours de groupe nous étions un peu serrés, ce qui ne nous empêchait pas de faire de la musique bien entendu.
Les journées de la première semaine se déroulaient sur le même schéma général : échauffement vocal collectif dans la « grande salle », puis deux heures de « musicianship » (basiquement cours de solfège), puis cours de direction de chœur. Pour ces deux cours, nous étions répartis en groupe de niveau. L’après-midi, cours spécialisé (j’ai pris « solfège avancé », ce qui correspondait en fait à un cours d’harmonie de niveau universitaire) puis répétition par pupitre des œuvres que nous allions donner en concert la deuxième semaine (j’y reviendrai). L’intégralité des professeurs étaient hongrois, et tous les cours se déroulaient en anglais (et comme nous étions très peu de francophones, l’essentiel des échanges entre les cours se déroulait aussi en anglais). J’ai particulièrement apprécié la professeur de solfège Anna Füri et le professeur de direction Dávid Farkasházi, très sympathiques et compétents.
Le cours de direction (j’étais dans le groupe avancé) était bien, nous avons pu rapidement faire de la musique car les membres du groupe déchiffraient et chantaient bien (et même très bien pour certains). C’était assez fascinant de voir comment ce groupe de personnes qui ne se connaissaient pas la veille, venant de plein de pays différents, pouvaient monter en quelques minutes une pièce de Mozart ou de Duruflé (compositeur sur lequel Dávid vient de terminer sa thèse, la toute première en hongrois sur cette figure de la musique française moderne). Les indications de Dávid étaient très claires et très pertinentes sur le plan de la gestique, ce qui permettait d’améliorer les diverses pièces chantées. Chaque jour c’est un stagiaire différent qui faisait la petite partie d’échauffement en début de cours, ce qui permettait de voir les différentes manières de faire suivant les pays.
Le cours de solfège était évidemment le moment le plus « kodalyen » de la journée, où nous passions deux heures en petit groupe (environ 16 personnes) sur tous les outils standards. Deux heures intenses de travail de l’oreille, de chant, de théorie. Anna était très dynamique dans son enseignement, et finalement nous ne voyions pas les deux heures passer. C’était très satisfaisant de pouvoir pratiquer cette pédagogie avec des personnes étant déjà à l’aise avec les outils, mais au tout début un poil déconcertant sur certains aspects, car il n’y avait là aucune adaptation comme on peut l’avoir lors des stages en France (exemple simple : pour le si on doit bien dire « ti », vu que le « si » sert pour le sol dièse). Un élément m’a surpris : le fait qu’ils chantent parfois en solfège fixe, avec les lettres. Nous avons pu voir deux cours de démonstration avec de jeunes élèves hongrois, c’était très intéressant.
Nous avons passé la seconde semaine avec la fusion entre le Séminaire (dont nous ne conservions en vérité que le cours de solfège quotidien) et le Symposium. Pour accueillir tout le monde, un deuxième lieu principal a été utilisé, le Centre Culturel de la ville, abritant notamment un grand Auditorium. Il y avait chaque jour des dizaines d’ateliers et de présentations de travaux universitaires, il était impossible de tout faire, il fallait faire des choix. J’ai privilégié les ateliers « actifs », ce qui m’a permis de faire entre autres choses un atelier de « ZeneZen », un atelier sur les principes Kodály appliqués aux pièces contemporaines de piano pour les débutants, deux ateliers sur le concept Kodály appliqué à la musique sud-américaine, une découverte du « Kokiriko » japonais. J’ai également eu la grande chance de voir en chair et en os Géza Szilvay, le créateur de la méthode Colourstrings ; son témoignage a été très inspirant. Il est à regretter qu’aucun Français n’ait animé d’atelier lors de ce séminaire, j’espère que nous nous rattraperons dans deux ans, au prochain Symposium qui se déroulera à Cork (en Irlande).
J’en viens à l’un des grands moments de ces deux semaines, le concert que nous avons donné dans la grande salle de concert de l’Académie Franz Liszt à Budapest. Je passe sur la préparation, qui a été intensive, avec différentes étapes, du travail en pupitre à la mise en place avec l’orchestre. Nous y avons donné plusieurs pièces, toutes de Kodály évidemment, avec surtout la mise au point du Budavári Te Deum, un chef d’œuvre incroyable dont nous avons donné une bonne version, emmenés par le chef renommé Péter Erdei, premier directeur de l’Institut de Kecskemét, qui a une énergie fantastique malgré son âge relativement avancé. Le concert a été filmé et a été diffusé par la télévision hongroise. Un très grand moment collectif.
Au-delà du contenu du Séminaire et du Symposium, cela a été un très grand plaisir de découvrir la Hongrie, un beau pays de ce que j’en ai vu, avec notamment deux jours passés à Budapest qui est une ville incroyable, grouillante de monde comme beaucoup de capitales, ce qui tranchait avec la tranquillité de Kecskemét (qui n’est pourtant pas une petite ville).
Un grand motif de satisfaction pour moi, c’est que je n’ai rien complètement découvert dans la pédagogie Kodály en faisant ce voyage, ce qui veut dire que les stages que j’ai pu suivre en France, notamment avec Grégory Ward puis avec les différents intervenants de La Voix de Kodály en France m’avaient déjà transmis beaucoup de choses. Je suis néanmoins extrêmement content de ces deux semaines, le fait de se sentir membre d’un courant international est très porteur. J’encourage donc toutes les personnes qui veulent appliquer en France les outils Kodály à chercher à faire le voyage. Malgré les contraintes d’organisation – et je remercie grandement Andrea Richard et Elisabeth Esclattier de m’avoir aidé dans la préparation de mon séjour – c’est une démarche qui vaut l’investissement.